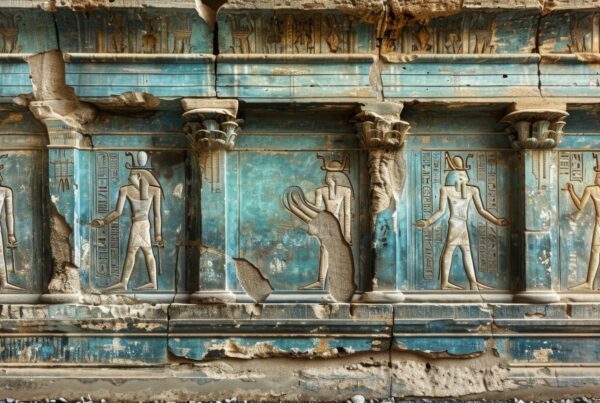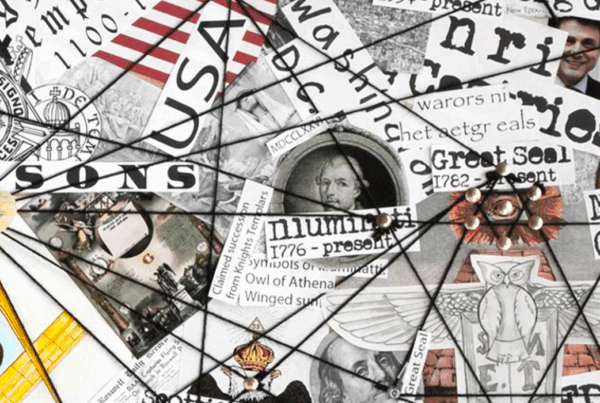Les théories du complot ne reposent pas seulement sur une idée : elles s’appuient sur une rhétorique bien rodée, faite d’arguments multiples, de stratégies de persuasion efficaces, et de méthodes qui rendent le débat difficile. Même si les récits changent, on retrouve souvent les mêmes techniques d’argumentation. Mieux les connaître, c’est mieux s’en protéger.
1- L’accumulation d’arguments : le “millefeuille argumentatif”
L’un des procédés les plus fréquents dans les discours complotistes est ce qu’on appelle le “millefeuille argumentatif”. Il ne s’agit pas d’un raisonnement logique et construit, mais d’une surcharge de données, d’arguments, de détails techniques ou scientifiques. Chacun pris séparément peut sembler anodin ou même erroné, mais l’accumulation crée une impression de solidité.
Surtout, ces arguments piochent dans des domaines complexes : biologie, climat, géopolitique, mathématiques… Ils donnent l’impression que “tout se tient”, qu’un vaste plan se dévoile à qui sait le lire.
👉 Exemple : Lorsqu’une personne affirme que les vaccins seraient dangereux, elle évoquera à la fois des brevets suspects, des conflits d’intérêts, des extraits d’études mal interprétés, des témoignages de médecins dissidents, des chiffres mal contextualisés… Difficile, face à un tel empilement, de tout déconstruire point par point.
2- Une posture d’antagoniste : “ceux qui savent” contre “les moutons”
Le discours complotiste repose souvent sur un clivage symbolique fort : d’un côté, “ceux qui savent”, les “éveillés”, ceux qui voient clair dans la manipulation. De l’autre, “les moutons”, la masse qui gobe tout sans réfléchir. Adhérer à la théorie du complot devient alors un marqueur d’intelligence ou de lucidité.
👉 Cette rhétorique joue sur l’identité : on ne croit pas à une théorie seulement pour ce qu’elle dit, mais pour ce qu’elle dit de soi. La rejeter reviendrait à être naïf ou complice. L’argument n’est plus “j’ai raison”, mais “je ne suis pas dupe”.
3- Une inversion du doute : du citoyen critique au justicier
Autre élément central : la rhétorique du citoyen engagé qui résiste à un mensonge généralisé. Normalement, quand un mensonge est soupçonné, on cherche les preuves. Mais dans les discours complotistes, la logique s’inverse : on part du principe qu’il y a un menteur, et qu’il faut ensuite trouver les preuves.
Cela donne une posture de quête morale : on devient un résistant, un enquêteur solitaire contre les puissants. Cela peut être valorisant, mais cela empêche souvent de remettre en cause la théorie elle-même.
👉 Exemple : Si une personne affirme que la Terre est plate, elle partira du postulat que la NASA ou les scientifiques en général mentent. Tout ce qui va dans le sens d’une Terre sphérique sera vu comme une manipulation. L’objectif n’est plus de chercher la vérité, mais de démasquer le mensonge présumé.
4- L’ironie et le sarcasme : armes de disqualification
La rhétorique complotiste utilise aussi des outils émotionnels puissants, comme l’ironie, la moquerie ou le ton condescendant. On ridiculise ceux qui doutent de la théorie, en laissant entendre qu’il faudrait être aveugle ou stupide pour ne pas voir “la vérité”.
Cette stratégie permet d’anticiper les critiques : si vous ne croyez pas à la théorie, c’est que vous êtes “un mouton”, “un endormi”, “un vendu”. Ce n’est plus un débat, mais un jeu de disqualification. Et oui qui voudrait passer pour un mouton qui refuse l’évidence !
Pourquoi c’est efficace ?
Ces stratégies ont un point commun : elles verrouillent la discussion. Chaque critique est intégrée comme preuve du complot. Chaque fait contraire est disqualifié. Et chaque personne qui doute est soupçonnée de faire partie du système. Cela rend la réfutation presque impossible.
Mais cela ne veut pas dire qu’on ne peut rien faire. Comprendre ces mécanismes, les reconnaître, en parler, c’est déjà un premier pas pour garder son esprit critique sans tomber dans l’hostilité.
À suivre…
Dans un prochain article, on pourra explorer pourquoi certaines personnes adhèrent plus facilement aux théories du complot : rôle des émotions, de la défiance, du sentiment d’exclusion… L’objectif n’est pas de juger, mais de comprendre les ressorts sociaux, psychologiques et numériques qui rendent ces récits si séduisants.
Sources : https://theoriesducomplot.be/