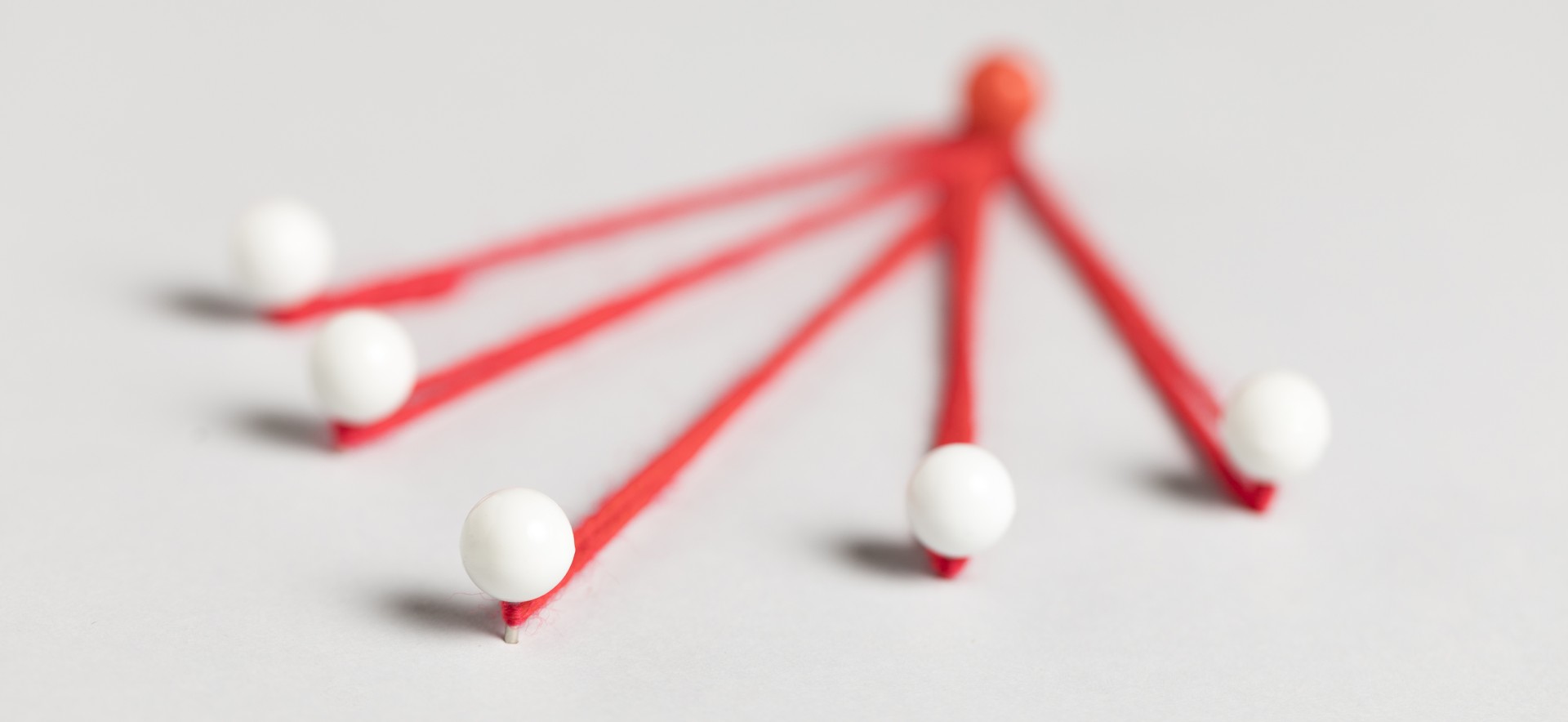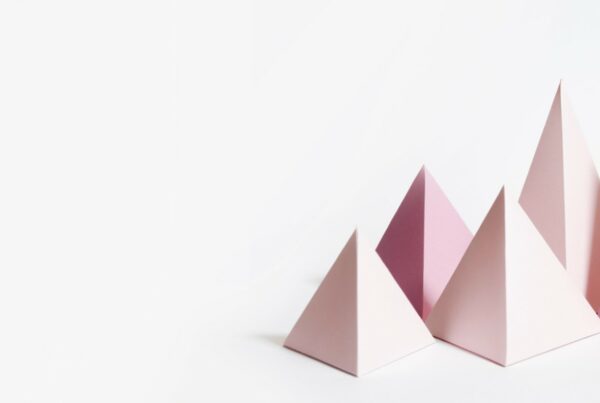Pourquoi a-t-on du mal à croire qu’un événement historique d’une ampleur exceptionnelle puisse avoir une cause toute bête ? Pourquoi l’idée qu’un président ait pu être assassiné par un tireur isolé semble moins crédible que celle d’un vaste complot orchestré par des forces occultes ? Pourquoi croit-on que les grandes catastrophes ont forcément de grandes causes ?
C’est ce qu’on appelle le biais de proportionnalité.
1- Qu’est-ce que le biais de proportionnalité ?
Le biais de proportionnalité est un mécanisme de pensée selon lequel un événement important, marquant ou dramatique doit forcément avoir une cause importante, marquante ou dramatique. À l’inverse, il nous semble intuitivement difficile d’accepter qu’un événement majeur puisse résulter d’une cause triviale, banale ou insignifiante.
« Un événement aussi énorme ne peut pas être dû à un simple accident, une erreur humaine ou une coïncidence. »
Alors on cherche (ou on invente) des causes plus grandes, plus complexes, voire mystérieuses. Mais en réalité, la taille de la cause n’a pas besoin d’être proportionnelle à celle de l’effet. Des événements majeurs peuvent résulter de décisions absurdes, de maladresses ou de facteurs très simples.
2- Pourquoi ce biais est-il si courant ?
Parce qu’il répond à trois grands besoins humains :
– Le besoin de sens : Face à un événement choquant (comme un attentat ou une catastrophe), on cherche une explication logique, cohérente, presque « réconfortante ». Une cause banale nous laisse dans l’inconfort de l’absurde ou de l’incertitude.
– Le rejet de l’aléatoire : On a du mal à accepter que de grandes tragédies puissent arriver sans que quelqu’un en soit responsable. Ce besoin de trouver un « coupable » nourrit souvent des récits conspirationnistes.
– L’effet dramatique : Les histoires aux causes « épiques », secrètes ou extraordinaires captent mieux notre attention. Notre cerveau préfère les récits frappants à la banalité des faits.
Ce biais joue un rôle central dans la manière dont nous interprétons certains événements, surtout lorsqu’ils sont tragiques ou spectaculaires. Voici quelques exemples où ce biais s’invite :
🕵️♂️ Les assassinats célèbres
Prenons l’exemple de l’assassinat de John F. Kennedy en 1963. Selon l’enquête officielle, un homme seul, Lee Harvey Oswald, aurait tué le président. Beaucoup de gens ont du mal à croire qu’un individu isolé ait pu changer le cours de l’Histoire à lui seul. Ce décalage entre la « petitesse » de la cause et la « grandeur » de l’effet nourrit depuis des décennies des théories du complot.
🦠 La pandémie de COVID-19
Autre exemple : la pandémie de COVID-19. Certains ont du mal à accepter que des milliards de vies aient été bouleversées à cause d’un virus issu de la nature (ou d’un accident de laboratoire). Face à cette réalité difficile à digérer, des théories fleurissent : virus volontairement diffusé, manœuvre des élites mondiales, etc. Le biais de proportionnalité nous pousse à chercher une cause proportionnelle à l’impact mondial de la crise.
🎥 Les films et récits
Dans les fictions aussi, ce biais est à l’œuvre. On nous a habitués à voir les grandes catastrophes causées par des ennemis puissants, des trahisons ou des organisations secrètes. Une panne causée par un simple oubli, une crise déclenchée par une erreur humaine ordinaire ? Moins « satisfaisant » pour notre cerveau.
3- Pourquoi ce biais est-il si puissant ?
Le biais de proportionnalité est profondément humain. Il répond à un besoin de logique, de sens et de justice : si quelque chose de grand se produit, il faut une grande cause. Sinon, c’est l’absurde… et c’est angoissant.
Mais ce biais nous rend parfois incapables d’accepter le hasard, la complexité, ou même la bêtise humaine comme facteurs explicatifs. Il fausse notre jugement, et peut nous pousser vers des interprétations erronées ou exagérées.
4- Ses effets dans la désinformation
Ce biais est souvent exploité par les récits complotistes ou sensationnalistes. Lorsqu’un événement choquant survient, certains acteurs malveillants ou mal informés vont chercher — ou inventer — une cause “à la hauteur” de l’événement. Cela rend la théorie plus « logique » ou plus séduisante que la réalité.
C’est aussi pourquoi certains discours médiatiques simplistes peuvent prospérer : ils proposent une explication “grande cause = grand effet” qui évite d’avoir à penser la complexité du réel.
5- Comment éviter l’illusion de fréquence ?
Pour éviter ce biais, il est important de maintenir un esprit critique et de s’appuyer sur des données objectives. Par exemple, plutôt que de se fier à la sensation que certaines choses se produisent plus souvent, il est préférable de vérifier les statistiques et de comparer les fréquences réelles des événements. De plus, prendre du recul face à des informations émotionnellement chargées ou sensationnelles peut aider à éviter de tomber dans ce piège. Enfin, être conscient de l’existence de ce biais et de ses mécanismes peut nous permettre de mieux le gérer et d’éviter de prendre des décisions basées sur des impressions erronées.
6- Comment lutter contre ce biais ?
Accepter que le monde est complexe, et que de petits événements peuvent parfois provoquer de grandes conséquences (effet papillon, chaos, etc.).
Vérifier les faits : une explication simple et “grande” n’est pas forcément la bonne.
Se méfier des raccourcis cognitifs qui cherchent à tout prix une symétrie entre cause et effet.
Questionner les récits “trop parfaits” : une grande catastrophe ne cache pas forcément un grand complot.
7- En résumé (encadré)
Le biais de proportionnalité nous pousse à croire que les grands effets doivent avoir de grandes causes.
Il est profondément enraciné dans notre manière de penser, car il nous aide à donner du sens à ce qui nous entoure.
Ce biais peut fausser notre compréhension du monde, et il est souvent exploité dans la désinformation et les théories du complot.
Pour bien s’informer, il est essentiel de reconnaître ce biais et de s’en méfier.