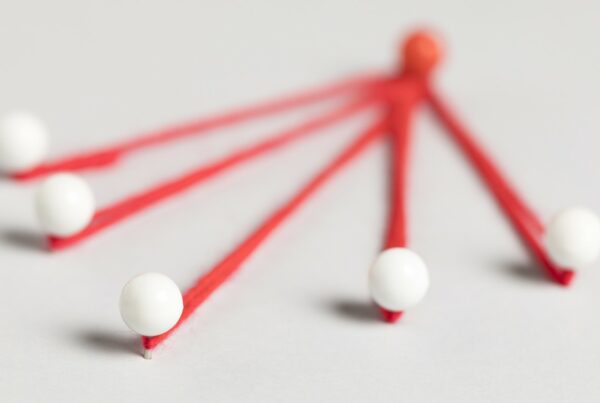L’illusion de fréquence est un biais cognitif qui nous pousse à surestimer l’omniprésence d’un événement ou d’une information simplement parce qu’on y a récemment été exposé. Après avoir appris ou remarqué quelque chose, notre cerveau commence à le repérer partout, même si sa fréquence réelle n’a pas changé. Dans un monde saturé de contenus, ce biais prend une ampleur particulière : certains phénomènes rares peuvent paraître bien plus courants qu’ils ne le sont vraiment.
1- Qu’est-ce que l’illusion de fréquence ?
Aussi appelée effet Baader-Meinhof, cette illusion tire son nom d’un groupe radical allemand des années 1970. Un lecteur du Saint Paul Pioneer Press, Terry Mullen, avait remarqué qu’après avoir découvert ce groupe, il avait soudain l’impression d’en entendre parler partout. Pourtant, aucune augmentation réelle de l’information à son sujet n’avait eu lieu : c’était simplement son attention qui s’était ajustée.
Le linguiste Arnold Zwicky a popularisé ce phénomène sous le nom d’illusion de fréquence : lorsque notre cerveau enregistre une nouvelle information, il la détecte plus facilement par la suite, ce qui donne l’impression trompeuse qu’elle est omniprésente.
2- Une combinaison de deux biais : attention sélective et biais de confirmation
Ce phénomène repose sur deux autres biais bien connus :
L’attention sélective : nous ne pouvons pas tout percevoir consciemment. Une fois que notre esprit s’attarde sur un élément précis, il commence à le remarquer plus souvent, alors qu’il nous échappait auparavant.
Le biais de confirmation : nous avons tendance à accorder plus de poids aux informations qui confirment ce que nous pensons déjà. Si nous croyons qu’un phénomène est fréquent, nous serons enclins à repérer tout ce qui va dans ce sens, et à ignorer le reste.
3- Comment l’illusion de fréquence se manifeste-t-elle ?
Ce biais est particulièrement visible dans des situations où un événement ou une idée devient marquant.
Par exemple, si quelqu’un apprend un nouveau mot ou une nouvelle expression, il peut commencer à l’entendre partout autour de lui, dans des conversations, à la télévision, dans des livres. Cela n’indique pas que le mot est soudainement devenu populaire, mais que la conscience de ce mot a augmenté, ce qui crée l’illusion que sa fréquence d’apparition est plus élevée.
De même, après avoir vu un certain type de voiture dans la rue, il nous semble que tout le monde conduit désormais cette voiture. Ce n’est pas parce que le nombre de ces voitures a augmenté, mais parce que notre cerveau les a désormais repérées.
L’illusion de fréquence peut également se manifester dans la perception des dangers. Par exemple, si un accident d’avion très médiatisé se produit, on pourrait avoir l’impression que les accidents aériens sont plus fréquents, même si statistiquement, ils restent relativement rares par rapport aux accidents de voiture. Cette perception erronée du risque peut amener certaines personnes à éviter de prendre l’avion, en dépit du fait qu’il soit en réalité l’un des moyens de transport les plus sûrs.
4- Les impacts de l’illusion de fréquence
Ce biais peut avoir des conséquences importantes dans plusieurs domaines :
→ Sur la perception du risque
Un événement marquant, comme une épidémie ou un attentat, peut sembler plus fréquent qu’il ne l’est vraiment, influençant nos comportements (peur de prendre l’avion, méfiance exagérée, etc.).
→ Sur les croyances et superstitions
Une coïncidence, comme voir un chat noir avant un échec, peut nourrir une croyance infondée si elle est perçue comme répétée.
→ Sur les décisions économiques
Un investisseur influencé par quelques événements marquants peut surestimer un risque ou un gain, menant à des choix impulsifs.
→ Dans les médias : une amplification involontaire (ou stratégique)
La surmédiatisation de certains sujets peut renforcer ce biais. Lorsqu’un événement tragique ou spectaculaire est abondamment relayé, il prend une place démesurée dans notre esprit, au point de sembler omniprésent.
Ce phénomène est accentué par le biais de sélection médiatique : les médias privilégient les sujets qui frappent l’opinion, au détriment de ceux plus fréquents mais moins spectaculaires. Cela peut déformer notre vision du monde et faire croire que certains problèmes sont omniprésents, alors qu’ils restent marginaux.
→ En politique : visibilité ≠ popularité
Les campagnes politiques exploitent parfois l’illusion de fréquence pour imposer certains thèmes (immigration, sécurité, etc.) ou faire croire à l’omniprésence d’un discours. Même si une idéologie est portée par une minorité très active sur les réseaux, elle peut donner l’impression d’être largement répandue grâce à sa visibilité.
→ Dans la désinformation : la répétition comme arme
La désinformation s’appuie largement sur ce biais. En répétant des fausses informations ou des théories du complot sur plusieurs canaux, les propagateurs donnent l’illusion qu’elles sont partagées par beaucoup, ce qui finit par les rendre crédibles pour certains.
5- Comment éviter l’illusion de fréquence ?
Pour éviter ce biais, il est important de maintenir un esprit critique et de s’appuyer sur des données objectives. Par exemple, plutôt que de se fier à la sensation que certaines choses se produisent plus souvent, il est préférable de vérifier les statistiques et de comparer les fréquences réelles des événements. De plus, prendre du recul face à des informations émotionnellement chargées ou sensationnelles peut aider à éviter de tomber dans ce piège. Enfin, être conscient de l’existence de ce biais et de ses mécanismes peut nous permettre de mieux le gérer et d’éviter de prendre des décisions basées sur des impressions erronées.